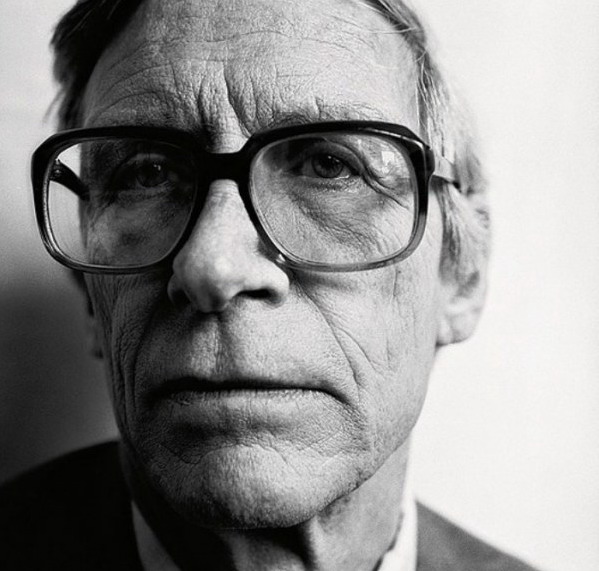Rawls, Théorie de la justice, 1971, Première Partie, Chapitre 1, § 1 « Le rôle de la justice », trad. Catherine Audard :
Posons, pour fixer les idées, qu’une société est une association, plus ou moins auto-suffisante, de personnes qui, dans leurs relations réciproques, reconnaissent certaines règles de conduite comme obligatoires, et qui, pour la plupart, agissent en conformité avec elles. Supposons, de plus, que ces règles déterminent un système de coopération visant à favoriser le bien de ses membres. Bien qu’une société soit une tentative de coopération en vue de l’avantage mutuel, elle se caractérise donc à la fois par un conflit d’intérêts et par une identité d’intérêts. Il y a identité d’intérêts puisque la coopération sociale procure à tous une vie meilleure que celle que chacun aurait eue en cherchant à vivre seulement grâce à ses propres efforts. Il y a conflit d’intérêts puisque les hommes ne sont pas indifférents à la façon dont sont répartis les fruits de leur collaboration, car, dans la poursuite de leurs objectifs, ils préfèrent tous une part plus grande de ces avantages à une plus petite. On a donc besoin d’un ensemble de principes pour choisir entre les différentes organisations sociales qui déterminent cette répartition des avantages et pour conclure un accord sur une distribution correcte des parts. Ces principes sont ceux de la justice sociale : ils fournissent un moyen de fixer les droits et les devoirs dans les institutions de base de la société et ils définissent la répartition adéquate des bénéfices et des charges de la coopération sociale.
Or, nous dirons qu’une société est bien ordonnée lorsqu’elle n’est pas seulement conçue pour favoriser le bien de ses membres, mais lorsqu’elle est aussi déterminée par une conception publique de la justice. C’est-à-dire qu’il s’agit d’une société d’une société où, premièrement, chacun accepte et sait que les autres acceptent les mêmes principes de la justice et où, deuxièmement, les institutions de base de la société satisfont, en général, et sont reconnues comme satisfaisant ces principes. Dans ce cas, même si les hommes émettent des exigences excessives les uns à l’égard des autres, ils reconnaissent néanmoins un point de vue commun à partir duquel leurs revendications peuvent être arbitrées. Si la tendance des hommes à favoriser leur intérêt personnel rend nécessaire de leur part une vigilance réciproque, leur sens public de la justice rend possible et sûre leur association. Entre des individus ayant des buts et des projets disparates, le fait de partager une conception de la justice établit les liens de l’amitié civique ; le désir général de la justice limite la poursuite d’autres fins. Il est permis d’envisager cette conception publique de la justice comme constituant la charte fondamentale d’une société bien ordonnée.
Bien entendu, les sociétés existantes sont rarement bien ordonnées en ce sens, car ce qui est juste et injuste est habituellement l’objet d’un débat. Les hommes ne sont pas d’accord sur les principes qui devraient définir les termes de base de leur association. Cependant, nous pouvons dire, en dépit de ce désaccord, qu’ils ont chacun une conception de la justice, c’est-à-dire qu’ils comprennent le besoin d’un ensemble caractéristique de principes et sont prêts à les défendre ; ces principes permettent de fixer les droits et les devoirs de base et de déterminer ce qu’ils pensent être la répartition adéquates des avantages et des charges de la coopération sociale. C’est pourquoi il semble naturel de considérer le concept de justice comme étant distinct des diverses conceptions de la justice et comme étant défini par le rôle qu’ont en commun ces différents ensembles de principes, ces différentes conceptions de la justice. Ceux qui ont des conceptions différentes de la justice peuvent alors, malgré tout, être d’accord sur le fait que des institutions sont justes quand on ne fait aucune distinction arbitraire entre les personnes dans la fixation des droits et des devoirs de base, et quand les règles déterminent un équilibre adéquat entre les devoirs de base, et quand les règles déterminent un équilibre adéquat entre des revendications concurrentes à l’égard des avantages de la vie sociale. Les hommes peuvent aussi être d’accord sur cette description de ce que sont de justes institutions ; en effet, les notions de distinction arbitraire et d’équilibre adéquat, qui sont comprises dans le concept de justice, sont laissées ouvertes à l’interprétation de chacun, selon ses propres principes de la justice. Ces principes identifient les ressemblances et les différences entre les personnes permettant la détermination des droits et des devoirs et ils précisent la répartition adéquate des avantages.
Idem, Première Partie, Chapitre 1, § 3 « L’idée principale de la théorie de la justice » :
Dans la théorie de la justice comme équité, la position originelle d’égalité correspond à l’état de nature dans la théorie traditionnelle du contrat social. Cette position originelle n’est pas conçue, bien sûr, comme étant une situation historique réelle, encore moins comme une forme primitive de culture. Il faut la comprendre comme étant une situation purement hypothétique, définie de manière à conduire à une certaine conception de la justice. Parmi les traits essentiels de cette situation, il y a le fait que personne ne connaît sa place dans la société, sa position de classe ou son statut social, pas plus que personne ne connaît le sort qui lui est réservé dans la répartition des capacités et des dons naturels, par exemple l’intelligence, la force, etc. J’irai même jusqu’à poser que les partenaires ignorent leurs propres conceptions du bine ou leurs tendances psychologiques particulières. Les principes de la justice sont choisis derrière un voile d’ignorance. Ceci garantit que personne n’est avantagé ou désavantagé dans le choix des principes par le hasard naturel ou par la contingence des circonstances sociales. Comme tous ont une situation comparable et qu’aucun ne peut formuler des principes favorisant sa condition particulière, les principes de la justice sont le résultat d’un accord ou d’une négociation équitable. Car étant donné les circonstances de la position originelle, c’est-à-dire la symétrie des relations entre les partenaires, cette situation initiale est équitable à l’égard des sujets moraux, c’est-à-dire des êtres rationnels ayant leur propres systèmes de fins et capables, selon moi, d’un sens de la justice. La position originelle est, pourrait-on dire, le statu quo initial adéquat et c’est pourquoi les accords fondamentaux auxquels on parvient dans cette situation initiale sont équitables. (…)
La théorie de la justice comme équité commence, ainsi que je l’ai dit, par un des choix les plus généraux parmi tous ceux que l’on puisse faire ne société, à savoir par le choix des premiers principes qui définissent une conception de la justice, laquelle déterminera ensuite toutes les critiques et les réformes ultérieures des institutions. Nous pouvons supposer que, une conception de la justice étant choisie, il va falloir ensuite choisir une constitution et une procédure législative pour promulguer des lois, ainsi de suite, tout ceci en accord avec les principes de la justice qui ont été l’objet de l’entente initiale. Notre situation sociale est alors juste quand le système de règles générales qui la définit a été produit par une telle série d’accords hypothétiques. De plus, si on admet que la position originelle détermine effectivement un ensemble de principes (c’est-à-dire qu’une conception de la justice y serait choisie), chaque fois que ces principes seront réalisés dans les institutions sociales, les participants pourront alors se dire les uns aux autres que leur coopération s’exerce dans les termes ils consentiraient s’ils étaient des personnes égales et libres dont les relations réciproques seraient équitables. Ils pourraient tous considérer leur organisation comme remplissant les condition stipulées dans une situation initiale qui comporte des contraintes raisonnables et largement acceptées quant au choix des principes. La reconnaissance générale de ce fait pourrait fournir la base d’une acceptation par le public des principes de la justice correspondants. Aucune société humaine ne peut, bien sûr, être un système de coopération dans lequel les hommes s’engagent, au sens strict, volontairement ; chaque personne se trouve placée dès la naissance dans une position particulière, dans une société particulière, et la nature de cette position affecte matériellement ses perspective de vie. Cependant, une société qui satisfait les principes de la justice comme équité se rapproche autant que possible d’un système de coopération basé sur la volonté, car elle satisfait les principes mêmes auxquels des personnes libres et égales donneraient leur accord dans des circonstances elles-mêmes équitables. En ce sens, ses membres sont des personnes autonomes et les obligations qu’elles reconnaissent leur sont imposées par elles-mêmes.